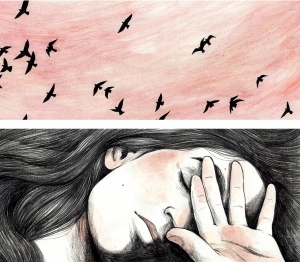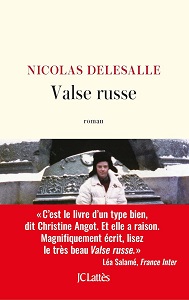 JC Lattès – août 2023 – 208 pages
JC Lattès – août 2023 – 208 pages
Quatrième de couverture :
Derrière la fenêtre de son compartiment, un Français d’origine russe regarde les forêts d’Ukraine défiler. Autour de son cou, une croix orthodoxe que lui a offerte sa
mère. Dans un pays mis à feu et à sang par les fils de ses ancêtres, c’est sa mère russe qu’il porte contre sa poitrine. C’était déjà sa mère, et professeure de russe, qui l’accompagnait lors de son premier voyage scolaire à Kiev en pleine guerre froide. Ou, en tant qu’interprète, pour son premier reportage dans la Russie des années 2000. Aurait-il pu l’imaginer alors interrogée par le KGB à dix-sept ans à Sébastopol ?
À quelques centaines de kilomètres de ce train qui l’emmène aujourd’hui vers Kiev, un vieil Ukrainien marche sur un lac gelé. Lui aussi porte une croix orthodoxe autour du cou. Ils ne se connaissent pas encore, mais bientôt ils vont partager un secret.
Une valse à trois temps, pour approcher le mystère des origines, entre fierté, désenchantement et renoncement. Une quête littéraire, intime et universelle. Un regard unique.
Auteur : Journaliste et écrivain, Nicolas Delesalle est actuellement grand reporter à Paris Match, après l’avoir été à Télérama. Il a dirigé l’ouvrage Télérama 60 ans et est l’auteur d’Un parfum d’herbe coupée, Le goût du large, Mille soleils, N’habite plus à l’adresse indiquée.
Mon avis : (lu en mars 2024)
Cette valse russe est une valse à trois temps car dans ce livre, trois histoires s’alternent.
Le premier récit est le témoignage de Nicolas Delesalle, grand reporter à Paris-Match durant la guerre en Ukraine. Il est arrivé à Kiev une semaine avant l’attaque russe du 24 février 2022. Le jour de l’invasion, il était dans le Donbass à la frontière avec la Russie, persuadé d’être au première loge… Il sera dans un train durant l’exode des premiers jours, des femmes et enfants ukrainiens de l’est vers l’ouest…
La deuxième récit est un retour dans les années 80, Nicolas est adolescent, il participe à un voyage scolaire en URSS avec sa classe et sa professeur de russe, qui est également sa mère. C’est une professeur assez fantasque, elle est convaincue que les Russes et les Français sont faits pour être amis. Ses grands-parents étaient des Russes blancs, obligés de fuir le pays après la Révolution de 1917. Malgré ses ancêtres slaves, Nicolas n’a jamais retenu ses leçons de Russe et ne parle pas la langue. A l’époque, il est fier de ses origines russes de par sa mère.
Lors de ses débuts de reporter en Russie, il partira avec sa mère comme traductrice. En 2022, lors d’un reportage auprès des personnes dont les habitations venaient de recevoir des bombes russes, il appellera sa mère pour qu’elle puisse donner, depuis la France, à travers le téléphone, un peu de réconfort à une femme sous le choc.
Le troisième récit raconte la rencontre entre Sacha, un vieil Ukrainien, vivant au bord d’un lac, à la frontière russe et Vania, un jeune russe recruté en prison par la milice Wagner. Dès les premiers coups de canons, Sacha est parti s’engager. Après quelques mois sur le front, Sacha est chargé de surveiller Vania, qui a été fait prisonnier lors de son premier combat. Sacha et Vania ont en commun le jeu des échecs.
Ces trois temps de la valse, plonge le lecteur dans ce conflit fratricide qui oppose la Russie et l’Ukraine, dans le réalisme de la guerre, décrite au plus près des hommes, des femmes et des enfants et avec beaucoup d’humanité. C’est également pour l’auteur un réflexion sur la quête de son identité.
Une lecture enrichissante et nécessaire.
Extrait : (début du livre)
L’hiver défile derrière la fenêtre du compartiment, avec ses forêts blanches et ses chemins de boue gelée qui ne mènent nulle part. Le train cahote sur les rails tordus par le froid. Je suis de nouveau en route pour l’Ukraine. Voilà un an, j’atterrissais à Kiev par un vol régulier, une semaine avant que le premier missile russe ne soit tiré sur la ville. Peu d’Ukrainiens croyaient à la guerre. Dans la capitale, les jeunes nous riaient au nez. Depuis, l’aéroport est abandonné au silence et à la poussière, certains de ces jeunes sont morts au front et tous les autres s’efforcent de continuer à vivre sous l’orage d’acier.
Je suis assis sur ma couchette. Je regarde ce paysage que j’ai déjà tant de fois contemplé depuis le début du conflit. Depuis le début de ma vie. Autour de mon cou se balance le dernier cadeau d’anniversaire de ma mère, une croix orthodoxe en or ciselée sur le modèle de celle de son propre père. Sur un coup de tête dont elle est coutumière, ma mère l’a fait fondre à partir de son alliance, qu’elle croyait avoir jetée après son divorce, et de ma médaille de baptême catholique dont j’avais oublié l’existence. Je suis athée et guère sensible au charme ostentatoire des chaînes en or, mais depuis ce jour, je porte cette croix orthodoxe russe. C’est un talisman, mes racines, mon histoire. Dans un pays mis à feu et à sang par les fils de mes ancêtres, c’est ma mère russe que je porte contre ma poitrine.
À quelques centaines de kilomètres de ce train qui m’emmène vers Kiev, un homme marche sur un lac gelé. Lui aussi porte une croix orthodoxe autour du cou. Il ne me connaît pas encore. Il est ukrainien, il s’appelle Sacha et, bientôt, il va partager son secret avec moi.
Déjà lu du même auteur :




 Albin Michel – mai 2023 – 432 pages
Albin Michel – mai 2023 – 432 pages



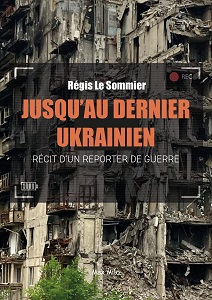 Max Milo – mars 2023 – 172 pages
Max Milo – mars 2023 – 172 pages Glénat – mars 2022 – 72 pages
Glénat – mars 2022 – 72 pages








 Plon – janvier 2023 – 281 pages
Plon – janvier 2023 – 281 pages




 Aux forges de Vulcain – octobre 2022 – 272 pages
Aux forges de Vulcain – octobre 2022 – 272 pages
 Albin Michel – mars 2022 – 512 pages
Albin Michel – mars 2022 – 512 pages

 Seuil – mars 2022 – 320 pages
Seuil – mars 2022 – 320 pages

 Casterman – septembre 2013 – 162 pages
Casterman – septembre 2013 – 162 pages




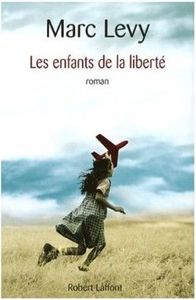
 Éditions Presque lune – janvier 2020 – 116 pages
Éditions Presque lune – janvier 2020 – 116 pages